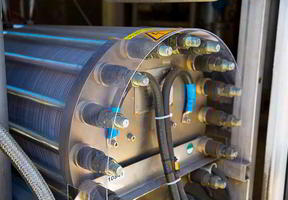Production d’électricité et émissions de CO2
Lecture 10 min
L’ , ce pilier invisible de notre quotidien, alimente nos industries, nos foyers, nos transports et nos technologies. Mais elle est aussi, en raison de ses modes de production, la principale responsable des émissions de CO2. Alors que notre monde s’oriente vers une “électrification” croissante, il est essentiel de passer des énergies fossiles aux . Un défi majeur pour notre avenir !

© EDF / GROLLIER PHILIPPE - Les usages de l'électricité sont multiples : dans l'industrie, l'habitat, les transports... Ici le tramway de Toulouse, dans le sud de la France.
Les modes de production de l’électricité
Les centrales thermiques à flamme : elles brûlent des énergies fossiles (surtout du charbon et du gaz naturel) ou de la (déchets ménagers ou végétaux). La combustion est utilisée pour produire de la vapeur d’eau qui fait tourner une turbine. Celle-ci est reliée à un alternateur qui convertit le mouvement mécanique en énergie électrique. Les centrales à charbon et à gaz sont les plus nombreuses et les plus émettrices de CO2. Le pétrole, sous la forme de fioul, est très peu utilisé dans la production électrique industrielle.
Les centrales nucléaires : la est produite par la fission d’atomes d’ ou de plutonium 239 dans un réacteur. La vapeur fait là aussi tourner un turbo-alternateur.
Les centrales hydrauliques : dotées elles aussi de turbines, elles utilisent la force de l’eau, soit en captant l’énergie d’une chute d’eau en montagne, soit en freinant le cours d’un grand fleuve ou d’un estuaire.
Les parcs éoliens : avec leurs immenses pales, les éoliennes captent la force du vent pour faire tourner les turbines. Les parcs éoliens, sur terre ou en mer, regroupent souvent plusieurs dizaines de machines.
Les parcs photovoltaïques : ils rassemblent des milliers de panneaux solaires, composés de semi-conducteurs principalement à base de . Ils convertissent directement la lumière du soleil en électricité.
Les technologies émergentes : certaines exploitent l’énergie des mers (houle des vagues, courants, etc.). La chaleur de la Terre à grande profondeur ( ) peut aussi être utilisée pour produire de l’électricité. Des centrales solaires thermiques à concentration captent la chaleur du soleil pour chauffer un fluide et faire tourner une turbine. L’ , utilisable dans les piles à , ouvre de vastes perspectives.
Des énergies fossiles vers les énergies renouvelables
La production électrique mondiale croît de plus en plus vite. Entre 2010 et 2022, elle a augmenté de 50 %. Entre 2022 et 2040, elle devrait connaître une croissance de 100 %, c’est-à-dire doubler. Puis augmenter encore de 25 % entre 2040 et 2050. Cette « électrification du monde » est due au développement des véhicules électriques, du chauffage résidentiel, des appareils électroniques, de la robotisation des usines, et bien sûr à l’accroissement de la population mondiale.
Cet essor spectaculaire va s’accompagner d’une profonde transformation des sources de production, qui vont basculer des sources fossiles vers les sources renouvelables, surtout solaire et éolien. Voici un tableau simplifié de cette révolution, qui indique les parts respectives des principales sources d’énergie dans la production électrique mondiale. Il s’agit du scénario proposé par
l’
pour atteindre «
» en 2050.
Parts des sources d’énergie dans la production électrique mondiale (scénario de l’AIE)
| Sources d'énergie | 2022 | 2050 |
| Charbon | 36% | 0% |
| Gaz naturel | 22% | 0% |
| Pétrole (fioul) | 2% | 0% |
| Nucléaire | 9% | 8% |
| Hydraulique | 15% | 11% |
| Eolien | 7% | 31% |
| Photovoltaïque | 4% | 41% |
Dans ce scénario, la part des fossiles tomberait de 60 % à près de zéro. Celle des renouvelables passerait de 26 % à 89 % (avec l’apport des bioénergies, du solaire thermique, de la géothermie et des énergies marines).
Electricité et gaz à effet de serre
La production d’électricité est responsable en 2022 d’environ 40 % des émissions mondiales de CO2. Dans ces émissions dues à l’électricité, 73 % proviennent des centrales à charbon, et 22 % des centrales à gaz. Il y a en effet une grande disparité entre les différents types de production. Le tableau suivant donne une indication des émissions de CO2 par nature de centrale, selon les calculs du GIEC. Elles sont exprimées en gramme d’équivalent CO2 par kWh (gCO2e/kWh). Elles incluent les émissions dégagées lors de la construction des centrales, celles dues à la production d’électricité elle-même, et éventuellement celles dues au recyclage des déchets produits. D’autres facteurs interviennent, comme le lieu de fabrication des matériaux ou le degré de modernité des centrales. Il s’agit donc de chiffres médians, très variables selon les pays.
Émissions de CO2 par type de centrale
| Type de centrale | Emissions (gCO2e/kWh) |
| Charbon | 820 |
| Pétrole (fioul) | 600 |
| Gaz naturel | 490 |
| Photovoltaïque | 48 |
| Hydraulique | 24 |
| Nucléaire | 12 |
| Eolien | 11-12 |