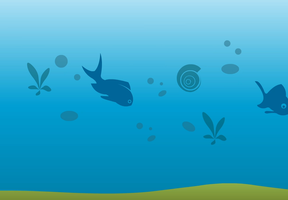Les compagnies pétrolières deviennent multi-énergies
Lecture 10 min
Les compagnies pétrolières historiques – les « majors » - ont connu en un siècle de fortes évolutions. D’abord dans leurs relations avec les pays producteurs. Ensuite dans leurs actions pour la « ». Elles deviennent aujourd’hui des productrices « multi-énergies » et des distributrices de gaz et d’ jusqu’aux particuliers.

© Giuseppe Ramos G
Les premières décennies
Tout commence au XIXe siècle, en 1859, quand l'Américain Edwin Drake extrait pour la première fois du pétrole par , à Titusville, en Pennsylvanie.
Deux grandes compagnies s’imposent peu à peu : la Standard Oil de l'Américain John Rockefeller, la Shell du Britannique Marcus Samuel. En 1911, la Standard Oil est devenue si puissante que le Congrès américain vote une loi anti-trust1 qui oblige la compagnie à se scinder en plusieurs sociétés.
La guerre de 1914-1918 consacre la primauté du pétrole comme moteur du développement économique. Sept compagnies pétrolières deviennent dominantes et sont connues sous le nom des Seven Sisters, les « sept sœurs » : Exxon, Mobil, Socal, Texaco, Gulf, BP, Shell. À ces sept sociétés, vient se joindre en 1924 la CFP (Compagnie française des pétroles), qui deviendra bien plus tard Total.
En juillet 1928, cinq compagnies (BP, Shell, Exxon, Mobil, CFP) signent les accords dits de la « Ligne rouge », qui consistent en un partage amiable des riches ressources pétrolières dans l'ancien Empire ottoman (c'est-à-dire de la Palestine à la péninsule arabique et à l’Irak).
Sur ces bases, se forment dans le Golfe plusieurs sociétés locales privées, les « consortiums », qui permettent de regrouper les moyens de prospection et assurent la liaison avec les gouvernements locaux. Après la seconde guerre mondiale, la part des revenus pétroliers reversés par les consortiums aux pays où sont situés les gisements augmente sensiblement, sans toutefois affecter les bénéfices des Seven Sisters.
Le choc pétrolier de 1973
La guerre de 1973 entre Israël et les pays arabes provoque un premier qui entraîne une hausse brutale du prix du .
Prenant conscience de leur nouveau poids géopolitique, les États producteurs de pétrole veulent contrôler eux-mêmes l'exploitation de leurs ressources pétrolières. Les grands groupes pétroliers doivent progressivement leur céder les droits d'exploitation des gisements et les consortiums qu'ils avaient fondés sont peu à peu nationalisés. Parmi ces consortiums, Aramco deviendra la compagnie nationale saoudienne et la première productrice mondiale de pétrole.
Les compagnies nationales décident des partenariats avec les sociétés mondiales candidates à l’exploitation. Elles établissent des contrats de concessions ou de partage de production.
XXIe siècle : vers des compagnies « multi-énergies »
Le besoin d’une « transition énergétique » pour faire face aux risques du a conduit à une mutation profonde des grandes compagnies pétrolières. A la fin du XXe siècle, un premier virage a été pris avec un fort développement des grands groupes pétroliers dans le gaz.
Une centrale à gaz émettant environ 50% moins de CO2 par kWh qu’une centrale à charbon, « le gaz apparaît donc comme une alternative (plus) « propre », quoique transitoire, pour les pays ayant beaucoup recours au charbon qui s’engagent aujourd'hui dans la transition énergétique »2.
Ils se sont ensuite diversifiés dans d’autres secteurs de l’énergie : les biocarburants, le solaire, l’éolien, l’ , le stockage du CO2, les batteries… BP est devenu actif dès les années 1980 dans le solaire et l’éolien terrestre. Le néerlandais Shell s’est lancé très tôt dans l’éolien en mer. Total est devenu majoritaire en 2011 chez le producteur américain de panneaux solaires Sunpower.
Produisant ainsi de l’électricité renouvelable, dans un marché de plus en plus ouvert, ces groupes ont logiquement décidé d’aller jusqu’au client final en devenant distributeur. L’italien ENI fournit de l’électricité aux ménages français. Le rachat de Direct Energie par Total en 2018 a fait entrer le groupe en compétition directe avec Engie (né de la anciennement GDF-Suez) et EDF.
Symboles de cette transition, les noms de certaines compagnies ont été changés. Le géant norvégien Statoil est devenu Equinor. Total est devenu TotalEnergies.
Il est à noter que ce mouvement vers des activités « multi-énergies » est plus net chez les multinationales européennes que chez les groupes nord-américains, qui sont devenus, grâce aux hydrocarbures de schiste, les premiers producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz du monde.
_________________
1 Loi limitant la constitution de très grandes entreprises dont la situation de monopole peut fausser le jeu de la concurrence.
2 « Quel place pour le gaz dans la transition énergétique », note d’analyse de France Stratégie.
Le top 20 des compagnies « multi-énergies »
|
Société |
Pays |
Chiffre d’affaires (en milliards de dollars) |
|
Saudi Aramco |
Arabie saoudite |
400,38 |
|
Sinopec |
Chine |
384,82 |
|
PetroChina |
Chine |
380,31 |
|
ExxonMobil |
États-Unis |
280,51 |
|
Shell |
Royaume-Uni |
261,76 |
|
TotalEnergies |
France |
185,12 |
|
BP |
Royaume-Uni |
158,01 |
|
Chevron |
États-Unis |
156,29 |
|
Lukoil |
Russie |
125,11 |
|
Russie |
117,30 |
|
|
Valero Energy |
États-Unis |
114,00 |
|
Phillips 66 |
États-Unis |
111,70 |
|
Rosneft |
Russie |
111,40 |
|
EDF |
France |
99,83 |
|
Enel |
Italie |
99,41 |
|
E.ON |
Allemagne |
91,44 |
|
Eni |
Italie |
90,50 |
|
Equinor |
Norvège |
88,37 |
|
Petrobras |
Brésil |
83,89 |
|
Engie |
France |
68,40 |
Source : Global 2000 du magazine Forbes. Le classement Forbes prend en compte quatre indicateurs (chiffre d’affaires, profits, actifs, valeur de marché). Nous n’avons retenu dans ce tableau que le chiffre d’affaires (entre avril 2021 et avril 2022).